« Tiens Monsieur C. ! Déjà réveillé ? »
Ça fait déjà plusieurs heures que Monsieur C. est réveillé. La tête tournée vers la fenêtre qui donne sur un mur. Ça fait des heures qu’il attend, assis au bord du lit. Il a réussi à s’extirper du matelas et à pivoter pour s’asseoir. Il n’a pas trouvé pas la manette pour redresser le lit. Il reste là, en attendant. Impossible de mettre la télé, il est trop tôt. Il ne peut pas sonner. D’ailleurs on lui a dit d’arrêter de sonner pour rien. Lui tout ce qu’il voudrait, c’est parler un peu.
Les rayons du soleil se sont mis à éclairer les visages sur le panneau de photos à l’entrée de la chambre. Dans toutes les chambres il y a le même panneau en liège. Entre les photos on voit encore les trous qu’ont fait ceux qui étaient là avant. Avant que quelqu’un décroche les photos en pleurant. Sur les photos tout le monde sourit. Ça respire la joie, la santé et la vie. Lui aussi il a fini par mettre ses photos sur le panneau en liège, histoire de se rappeler qu’il a été un homme, un mari, un père, un collègue, un grand-père.
Cet après-midi c’est la petite qui va venir le voir. Faudrait pas qu’il se plaigne, pour d’autres personnes ne vient. Mais elle va encore lui demander s’il a passé une bonne semaine. Elle n’a pas compris qu’ici il n’y a plus de semaine, ni vraiment de jour et de nuit. Ici le temps marche avec un déambulateur. Il avance par petites tranches de tâches à accomplir : la toilette quotidienne avec le gant, la grande expédition à la douche une fois par semaine, la promenade dans le couloir, se rendre jusqu’à la salle à manger… Bon dieu c’que ça peut être loin une salle à manger. Monsieur C. déteste cette salle. Tous ces dentiers qui mastiquent, c’est le temps qui lui fait la grimace. Pourtant parfois il rit, ça lui rappelle la cafétéria quand il était môme, et celle de l’armée. Et puis ça le change du lit et de la chaise près de la fenêtre qui donne sur un mur. Ce lit, c’est là où il va passer de plus en plus de temps. C’est là qu’il attendra que la douleur passe, là qu’un jour la douleur passera tout à fait. C’est signé. La dernière scène de sa vie se passera là, dans ce lit qui n’est pas le sien, qui sera celui d’un autre une semaine plus tard, dans des draps qui n’ont plus l’odeur d’un chez soi. La dernière chose qu’il verra ce seront ces murs d’un blanc trop propre. (extrait d’un manuscrit : Quelque chose tombe et ce n’est pas la nuit)
Combien parmi nos parents vivront cette fin de vie ? Dans notre société est vieillissante, le nombre de retraités dépassera bientôt le nombre d’actifs. Si le débat sur la fin de vie est souvent relancé, celui sur l’existence même des maisons de retraite ne semble pas poser problème. Pourtant les maisons de retraite sont un choix de société, qui répond à des normes anthropologiques.
Lorsque les conditions dans lesquelles vivent beaucoup de personnes placées en maison de retraite surgissent dans l’actualité, le débat public se tourne vers comment offrir de meilleures conditions de vie, comment mieux placer les retraités. Mais la question culturelle de fond n’est pas abordée.
Nos parents : les futurs improductifs
«Je ne sers plus à rien», «Je ne veux plus embêter personne». Le taux de suicide chez les 75/84 ans est le seul qui augmente en France.[1]
Dans nos sociétés modernes, la norme familiale est la famille nucléaire – père, mère, enfant. L’éclatement familial, les familles recomposées, la mobilité des ménages éloigne beaucoup d’enfants de leurs parents. Les maisons de retraite apparaissent donc comme le seul choix possible, mais elles répondent en fait d’avantage à des normes culturelles encourageant l’isolement des générations, l’enfermement, le culte de la vie et la primauté de la santé du corps sur la santé émotionnelle. Mais surtout, la notion d’utilité de l’individu dans une société productiviste.
Dans une société où le but assigné à l’individu est de produire de la valeur économique, le fait qu’une personne puisse se mettre à travailler à mi temps pour s’occuper de ses parents n’est pas envisageable. On accorde des congés maternité, mais pas de congé filial.
Les improductifs sont relégués à des milieux d’enfermement : l’école, les hôpitaux psychiatriques, les prisons, les foyers pour personnes à la rue, les maisons de retraite. Bien sûr certains sont là pour apprendre, d’autres pour payer une dette envers la société, d’autres pour qu’on prenne soin d’eux. Milieu d’enfermement n’a pas ici une connotation péjorative : c’est un fait, nous enfermons ceux que nous voulons punir, former ou aider. Pourtant il n’est pas universel de considérer que l’apprentissage, la punition ou l’aide passent nécessairement par un isolement. Dans nombre de sociétés, l’apprentissage des enfants se fait par leur participation à la vie communautaire, et notamment par le soin qu’ils doivent prendre des anciens.
Chez nous, les personnes âgées sont considérées comme une classe à part avec, comme les enfants, qui ont leur propre nourriture, leurs séries télé, leurs amusements, ou leur niveau de langage qui nous amène souvent à les infantiliser. Dans d’autres sociétés pourtant, l’ancien est considéré(e) comme un trésor humain essentiel à la transmission vers les nouvelles générations.
Mais comment peut-on faire autrement ? Comment restituer la dignité et la place des personnes âgées dans notre société ? C’est que derrière cette question, c’est un modèle entier qui est remis en question. L’argument énonçant que nous n’avons pas le temps de nous occuper de nos parents et pas d’argent pour employer du personnel spécialisé, repose sur des rythmes de vie que nous nous ne remettons jamais en question. Impossible d’imaginer par exemple, qu’une partie d’un service civique obligatoire se ferait dans les maisons de retraite, d’imaginer pour chaque employé au sein d’une entreprise quelques jours de travail par mois dans une maison de retraite, ou encore d’établir des échanges de service avec des étudiants en quête de logement.
Dans nos sociétés où l’unité de mesure est l’individu économiquement productif, les personnes âgées redeviennent des enfants, mais des enfants qui marchent à reculons. Passé un certain âge, nul besoin d’avoir une maladie dégénérative pour se faire infantiliser. Dès lors, c’est à nous qu’incombe la responsabilité de mettre nos parents en maison de retraite. Bien sûr ils sont consentants, ils suivent nos conseils, puisqu’il est entendu que nous savons mieux ce qui est bon pour eux. Nos décisions sont difficiles à prendre, car nous sommes piégés dans un système où ça ne se fait pas de demander à la voisine « Je sors faire des courses, peux-tu t’occuper de ma mère pendant une heure ? », et la voisine de le faire, sans être rétribuée, parce qu’elle se sent concernée par toute personne âgée qui a contribué à créer la société où elle vit. Ça ne se fait pas de dire à son enfant de s’occuper de son grand-père en rentrant de l’école, un enfant ça doit rester dans son monde.
La mort est un verbe
Derrière notre relation aux personnes âgées, c’est aussi notre rapport à la mort qui est en question. Objet de spectacle dans les films, les médias et les jeux vidéos, mais absente du réel, elle n’a plus d’odeur, plus de température, plus de rythme. Nous ne savons plus à quoi ressemble la mort d’un animal que nous allons manger, nous n’assistons plus à la mort de notre personnes âgées Les personnes qui vont mourir sont mises à l’écart.
Dans un monde où les fruits n’ont plus de saison, où nous sommes entièrement coupés des cycles naturels, nous nous sommes aussi coupés de la mort. Au point de ne pas pouvoir en prononcer le nom. Nous disons partir, disparaître, c’est fini. À l’échelle des sociétés, nous vivons comme des immortels, dans une logique de croissance perpétuelle. À l’échelle individuelle, quand la mort approche, nous ne savons plus comment l’accueillir. Pourtant la mort est un verbe, le dernier de notre vie.
Nous nous occupons plus de la mort que de mourir. Nous la ritualisons à l’enterrement, une fois qu’elle est là, pour ceux qui restent. Mais pas pour celui qui meurt. La mort n’est souvent évoquée que pour la repousser ne dites pas ça, arrêtez de parler comme ça, ou bien éludée dans les blagues lors des visites familiales. Qui songerait à organiser des funérailles du vivant de la personne où, pendant plusieurs jours, les proches viendraient lui dire ce qu’elle a été pour eux, et lui liraient ces mots qui se disent devant le cercueil ? Et permettre à cette personne d’acquérir un statut de transmission, en se racontant ?
La plupart des décès en maison de retraite ont lieu la nuit ou tôt le matin, c’est-à-dire au moment où les angoisses sont les plus présentes. Par quel étrange procédé sommes-nous convaincus que des personnes qui arrivent au bout du chemin souhaitent qu’on les laisse tranquilles, baignés d’ennui, dans une chambre qui ressemble à toutes les autres, avec une couche au cul et une sonnette au bras, et que la télé est leur dernier plaisir ? Qui nous dit qu’ils ne voudraient pas s’épuiser encore un peu pour voir de nouveaux visages, des paysages apaisants, rire aux éclats, découvrir encore des choses qu’ils n’ont jamais vues ? Comment en est-on arrivé à empêcher les vieux de vivre sous prétexte de vouloir les maintenir en vie ? Il ne tenait qu’à nos parents de nous avoir mis en pension quand ils peinaient à subvenir à leurs besoins. Il serait peut-être urgence de réinterroger la place pour ceux qui, pour le meilleur ou le pire, nous ont construits.
[1] http://www.infosuicide.org/reperes/epidemiologie/
Trouve le verbe de ta vie ed La Nage de l’Ourse. Cliquez ici pour en savoir plus. Cliquez sur le livre pour le commander chez l’éditeur.
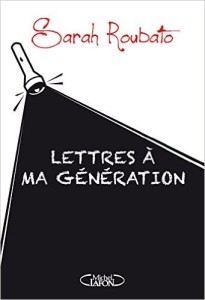 Lettres à ma génération ed Michel Lafon. Cliquez ici pour en savoir plus et lire des extraits. Cliquez sur le livre pour le commander chez l’éditeur.
Lettres à ma génération ed Michel Lafon. Cliquez ici pour en savoir plus et lire des extraits. Cliquez sur le livre pour le commander chez l’éditeur.



 Français
Français English
English


» Il n’a pas trouvé pas la manette pour redresser le lit.» faudrait éditer ce passage.
[…] À lire aussi : Comment mourront nos parents demain ? […]
je découvre depuis une semaine votre site et je suis conquise par la fluidité et la qualité de vos écrits, la pertinence de vos réflexions et la poésie qui en émane. Je suis en accord profond avec chaque mot, chaque virgule que je lis ici et ce n’est pas courant. Je crois avoir trouvé en vous la personne qui incarne au mieux notre époque, notre génération de trentenaires et la société dans laquelle nous vivons.
Je me souviens de la maison de retraite où nous avions dû mettre ma grand-mère, pourtant mère de 7 enfants. Au bout d’une semaine elle ne savait plus marcher. Ils les collaient dans des fauteuils roulants sous prétexte que, en fait c’était bien plus pratique. Une maison de retraite ultra moderne et sans humanité aucune. Ses filles ont réussi à la sortir de là et elle a fini sa vie doucement, dans une maison réservée aux anciennes bonnes soeurs, certes pas moderne pour un sou, mais avec des soignants aimants, un joli jardin, un bâtiment qui ressemblait à ceux dans lesquels elle avait vécu et auprès de sa propre soeur, Il me reste aujourd’hui une grand-mère, à un stade de démence avancé. Ses enfants ont réussi à la maintenir dans son appartement, avec une autonomie réduite mais réelle. L’un de ses fils fait le lien quotidiennement avec les auxiliaires de vie qui se relaient le jour, et l’étudiante qui occupe une chambre la nuit. Une solution provisoire qui dure depuis des années maintenant, à cause de la seule obstination de ce fils qui refuse d’abandonner sa mère.
Cette société nous a tellement morcelé qu’on n’envisage plus de cohabiter avec nos parents lorsqu’ils se mettent à avoir besoin de nous. Pourtant, quel enfer d’imaginer mes propres parents vieillir en maison de retraite ! Une fois qu’on a vu, on ne peut pas être complice de ce système carcéral. Voilà pour mon commentaire, et encore merci pour votre travail indispensable.