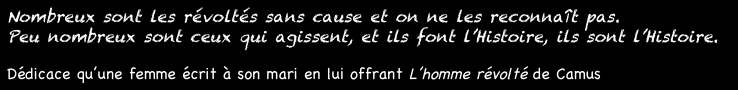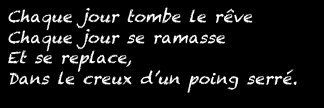Chanson pour la Nuit Debout, « Un homme qui vient », à écouter en cliquant sur la photo
Jeudi 38 mars 2016
Dans ce pays, le rêve est difficile. Je ne parle pas du rêve qui se chante derrière un slogan et s’éteint une fois rentré chez soi, une fois l’euphorie passée, ni de la vague envie qui dort dans un lieu qu’on appelle un jour, quand j’aurai le temps. Je parle d’un rêve qui s’implante dans le réel. Un rêve qui connaîtra des jours maigres, qui trébuchera, qui se reformulera. Un changement qui ne se déclare pas, mais qui s’essaye, les mains dans le cambouis du quotidien. C’est un rêve moins scintillant que celui des cris de guerre et des appels à la révolution. Il ne produit qu’une rumeur qui gonfle, et vient s’échouer sur nos paillassons, à l’entrée de nos vies. Elle s’étouffera peut-être, à force de se faire marcher dessus par tous ceux qui ont plus urgent à faire.
C’est un pays où les gens passent plus de temps à fustiger ce qui ne va pas qu’à proposer des alternatives, où l’on dit plus facilement “Le probème c’est…” plutôt que “La solution serait…”. Et pourtant… c’est de ce pays qu’est en train de gronder une rumeur, celle d’un rêve qui se réveille, et qui passe sa Nuit Debout.
Il est facile de dire ce que nous voulons – une vraie démocratie, l’égalité des chances, le respect de la terre – et encore plus facile de dire ce que nous ne voulons pas. Bien plus difficile de dire comment nous voulons y arriver. Car voilà qu’il faut discuter, négocier, évaluer, faire avec le réel.
Pourtant, partout dans le monde, et ici aussi, des semeurs cultivent le changement. Manger autrement, se chauffer autrement, éduquer autrement, vivre ensemble autrement, s’informer autrement. Ils voient leurs aînés, leurs voisins de rue, de métro ou de bureau, n’être que les rouages d’un système auquel ils ne croient plus. Les miroirs sont brisés : les citoyens ne se reconnaissent plus dans leurs élus, dans leurs médias, dans leurs écoles. Et pourtant… pourtant ils votent encore sans conviction, ils écoutent encore la messe de 20 heures et disent à leurs enfants de bien faire leurs devoirs. Il sera toujours plus facile de changer une loi que de changer une habitude, une indifférence ou une peur. Chaque jour, les semeurs luttent contre ces ennemis, bien plus redoutables que ceux dont on veut bien parler.
La génération du Grand Écart
Et moi dans tout ça ? Moi la jeunesse, moi l’avenir, moi Demain ? On m’a collé sur le front bien des étiquettes, mais elles sont tombées les unes après les autres. Ça doit être le réchauffement climatique qui le fait transpirer.
On me parle d’une génération Y, à laquelle j’appartiendrais de par mon année de naissance et mon utilisation supposée des nouvelles technologies. Ou d’une catégorie sociale – jeune, sans emploi, précaire – basée sur mon statut économique. On me parle aussi d’une communauté culturelle, basée sur le pays d’origine de mes parents, et on m’appellera Français d’origine… Pourtant, c’est loin de ces catégories que se retrouvent les gens qui font partie de ma génération, celle qui ne se définit ni par l’âge, ni par la profession ni par le statut socio-économique, ni par l’origine ethno-culturelle. Ils ont 9 ans, 25 ans, 75 ans, vivent au coeur de Paris ou dans une bergerie au pied d’une montagne. Ils sont ouvriers, paysans, professeurs, artistes, chercheurs, médecins, croyants ou athées; leurs origines culturelles chatouillent tous les points cardinaux. Qu’est-ce qui nous lie ? Qu’est-ce qui forme notre nous ?
C’est une posture partagée. Le geste que nous imprimons dans le monde, celui par lequel un sculpteur pourrait nous saisir. La génération rêveuse et combattante de 68 était celle du poing levé et des yeux fermés. La nôtre sera celle qui voit ses pieds s’écarter à mesure que grandit une faille qui va bientôt séparer deux mondes. Celui du capitalisme consumériste en train d’agoniser, et l’autre, celui qui ne connaît pas encore son nom. Un monde où nos activités – manger, se maquiller, se divertir, se déplacer – respectent le vivant, où chacun réapprend à travailler avec son corps, s’inscrit dans le local et l’économie circulaire, habite le temps au lieu de lui courir après. Un monde où les nouvelles technologies n’effacent pas la présence aux autres, et où la politique s’exerce au quotidien par les citoyens.
C’est un monde qui jaillit du minuscule et du grandiose ; du geste dérisoire d’un inconnu qui se met à nettoyer la berge d’une rivière aux Pays-Bas, et du projet démentiel d’un ingénieur de dix-neuf ans pour nettoyer les océans avec un immense filtre.
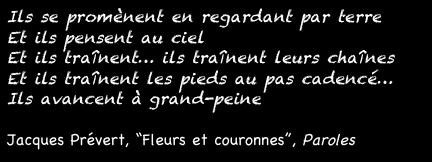 Chacun choisit son geste pour répondre à la crise : beaucoup attendent que ça passe, et ferment les yeux en espérant ne pas se retrouver sur la touche. D’autres, inquiets de voir s’amenuiser les aides et les indemnisations, s’acharnent à colmater les brèches d’un monde en train de se fissurer. Ils descendent dans la rue pour préserver le peu que le système leur laisse pour survivre. Certains réclament un vrai changement, pendant que d’autres, loin des mouvements de foule, l’entreprennent chaque jour. Quand les deux se rencontreront, ce sera peut-être le début de quelque chose.
Chacun choisit son geste pour répondre à la crise : beaucoup attendent que ça passe, et ferment les yeux en espérant ne pas se retrouver sur la touche. D’autres, inquiets de voir s’amenuiser les aides et les indemnisations, s’acharnent à colmater les brèches d’un monde en train de se fissurer. Ils descendent dans la rue pour préserver le peu que le système leur laisse pour survivre. Certains réclament un vrai changement, pendant que d’autres, loin des mouvements de foule, l’entreprennent chaque jour. Quand les deux se rencontreront, ce sera peut-être le début de quelque chose.
À la fin de chaque journée, je ressens toujours la même courbature. C’est le muscle de l’humeur qui tire. Je fais le grand écart, entre enthousiasme et désespérance. J’ai l’espoir qui boite. On avance comme on peut.
J’avance en boitant de l’espérance
Chaque semaine, j’entends parler d’un nouveau média – une revue papier à cheval entre le magazine et le livre, un journal numérique sans publicité, une télé qui aborde les sujets dont on ne parle pas. Des gens qui cherchent une autre manière de comprendre le monde, qui pensent transversal et qui prennent le temps de déplier les faits. Et chaque soir pourtant, je vois la même lumière bleutée faire clignoter les fenêtres à l’heure de la messe de 20 heures. Dans une heure, ce sera le Grand Débat. La Grande Dispute de ceux qui nous gouvernent. Les voilà penchés au-dessus du lit de notre société malade, comme ces médecins qui débattaient pendant des heures sur la façon de bien faire une saignée.
– Il faut tirer la croissance par le coude gauche !
– Non ! Par le droit !
– C’est ce que vous répétez depuis vingt ans, et regardez le résultat ! C’est par le troisième orteil qu’il faut la tirer ! Et le chômage il faut le réduire en lui faisant subir un régime drastique !
– Certainement pas ! Il faut lui tronçonner les cervicales ! Il perdra d’un coup vingt centimètres !
– Si vous faites ça vous allez avec une repousse par les pieds ! la seule solution c’est d’attaquer le problème aux extrêmités : élaguer les membres inférieurs et postérieurs, 2 cm par an.
Droite, gauche, centre essayent de nous faire croire qu’ils ne sont pas d’accord.
Je fais défiler la roulette de ma souris. Ça y est, Boyan Slat, dix-neuf ans, qui avait lancé l’idée d’un filtre géant pour nettoyer les océans, a obtenu la première validation de son expérience. Je souris, et fais défiler la page. Prochain article : Berta Caceres, une femme qui luttait contre la construction d’un barrage sur des terres autochtones a été assassinée dans les Honduras. Mes mâchoires se resserrent. Mon doigt hésite. Sur quel article cliquer ? Vers quel côté de la fente aller ? Les deux visages se font face devant mes yeux. Deux combattants, deux espérants, qui nous offrent à la fois toutes les raisons d’y croire, et toutes les raisons de renoncer. Tant pis, je cliquerai plus tard. J’ai un rendez-vous. C’est important, les rendez-vous. Surtout à Paris.
En sortant je descends mon sac de cartons, papiers et plastique. La beine à recyclage est pleine à craquer. Tant pis, je vide mon sac dans la poubelle. Dans la rue, mon téléphone sonne. Pas le temps de mettre l’oreillette. Je m’enfile quelques ondes dans le cerveau. Au bout du fil, un ami qui vit dans un hameau de douze habitants dans le sud : “Depuis quatre jours on s’est occupé à sauver un magnolia centenaire de la tronçonneuse municipale”. Ils étaient quatre, ils se sont enchaînés à l’arbre. Le magnolia est sauvé – Je souris. Mais quelque chose m’aveugle. C’est le panneau publicitaire à l’entrée du métro. Cet écran consomme autant que deux foyers – Je me crispe. L’année dernière, la municipalité de Grenoble n’a pas renouvelé les contrats avec les publicitaires, et les remplace progressivement par des arbres – Je souris. Une dizaine de chaussures Converse et Nike me ralentissent. Un groupe d’adolescents. Les bouteilles de Coca et de Sprite dépassent de leurs sacs plastiques. Ils se passent un sac de chips et une barquette de Fingers au Nutella. Il paraît que c’est pour eux qu’il faut qu’on se batte – Je me crispe. Il y a deux semaines, Ari Jónsson, un étudiant en design de produits islandais, a présenté son invention : une bouteille en bioplastique qui se dégrade en fertilisant naturel – Je souris. J’avance en boitant de l’espérance.
Serait-il impossible de vivre debout ?
Depuis une semaine, des milliers de personnes ont décidé de se mettre debout. Sans porte-parole, sans leader charismatique – par manque ou par choix ? – comme pour dire que le mythe de l’homme providentiel était de l’autre côté, et qu’il fallait trouver autre chose.
Je ne sais ce qui transforme une manifestation en mouvement populaire. Je sais que le vote d’une foule n’est pas la démocratie. Qu’un slogan n’est pas une proposition. Qu’il faut de l’humilité pour que sa parole porte loin. L’art de la parole publique n’est pas de parler de soi devant les autres, mais de parler des autres comme de soi. Je sais que si tous ceux qui se sentent dépossédés de leurs droits se retrouvent pour parler, c’est déjà beaucoup. Je sais que Paris n’est pas la France, et que beaucoup d’idéaux écrits sur le bitume sont déjà mis en oeuvre dans les campagnes, loin des micros des grands médias. La Nuit Debout n’a peut-être pas vocation à devenir un parti politique ou un mouvement tel que nous le comprenons dans le système actuel. Elles sont le laboratoire d’exploration d’un changement démocratique. Le défi sera sans doute que cette prise de parole et ces rencontres citoyennes perdurent dans le quotidien de chacun, une fois les occupations de la rue passées. À moins que la rue ne devienne un lieu de rendez-vous régulier. Elles sont un laboratoire où tous les possibles sont permis. Il faut avoir le courage de donner une chance à ses rêves. Histoire de dire qu’au moins, on aura essayé.
photo : Francis Azevedo
Sarah Roubato vient de publier Lettres à ma génération chez Michel Lafon. Cliquez sur le livre pour en savoir plus et ici pour lire des extraits. 



 English
English Español
Español