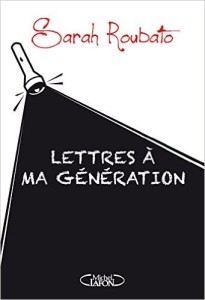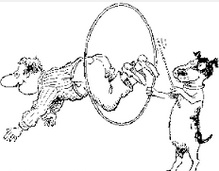Il a suffit d’un pas. Ma présence est devenue sacrilège. Je le regarde filer, porté à toute vitesse par la peur de moi.
Notre époque de la vitesse, des multitâches et de la communication à distance nous pose chaque jour la question de la présence à ce qu’on fait. Quand je mange, quand je prends un verre avec quelqu’un, quand je voyage en train, quand je marche en montagne, est-ce que je suis présent.e à mon geste ? Quel rapport au monde je suis en train d’instaurer à chaque instant ? Est-ce que je fais ce que je suis en train de faire en attendant autre chose, à la place d’autre chose, en faisant autre chose ? Une rencontre manquée avec un cerf m’a appris comment marcher sur les chemins de ma vie.
Le boucan dans ma tête
C’est le temps que j’aime tant des entre-saisons. Les fleurs des noisetiers commencent à cacher les sommets encore enneigés. Au sol, au milieu du tapis de feuilles d’automne qui a passé tout l’hiver sous la neige, les premières fleurs de forêt s’installent. La présence est un muscle. À force de la pratiquer, elle devient de plus en plus facile et de plus en plus évidente. Depuis le temps que je pratique la marche en forêt, mon cerveau se tait de plus en plus vite, pour laisser place aux sensations. Je deviens alors un paquet de sens, une véritable antenne sur pieds qui perçoit le moindre crissement de feuilles ou battement d’ailes. Mais parfois, quand ce qui m’encombre est vraiment trop collant, je l’embarque avec moi. Tout en marchant, je pense à ce un énième refus de manuscrit, à ma dernière oeuvre sonore que personne n’écoute, à ce projet refusé. Je cherche à quoi m’accrocher, pour maintenir l’espoir en vie. Mais l’espoir est une tension, alors je marche tendue. Je trace sur le sentier, en espérant qu’au bout, j’aurais pu faire tomber un peu du boucan de ma tête.
La rencontre manquée
Le voilà… et je n’ai rien vu. Qu’une silhouette magnifique qui fuit devant moi. Les bois d’un jeune cerf adulte, qui déjà prennent une forme majestueuse. Je reste figée, engluée dans mon pas qui l’a fait fuir. Dégoûtée, en colère. Je viens de manquer une de ces rencontres miraculeuses où tu te sens privilégié, humilié – dans l’authentique sens de celui qui gagne en humilité – car remis à ta juste place dans le vivant. À ce moment, tout ce que tu espères, c’est que l’animal t’ignore, et qu’il continue sa vie tranquille. C’est le plus beau cadeau qu’un animal sauvage puisse te faire : t’ignorer, car il te montre par là que tu n’es pas un danger. Alors tu oublies le froid, la crampe ou la faim. Tu restes là où il t’a surpris, et tu cueilles cet instant privilégié dans la pluie et le vent. Quand tu en ressors, tu as pris une autre dimension. Aujourd’hui ça ne m’arrivera pas. Pétrifiée devant les branches qui bougent encore, je ramasse les regrets d’une rencontre manquée, et j’écoute la leçon.
La leçon
Je n’ai rencontré des animaux sauvages que quand je ne les attendais pas. Mais si je ne suis pas prête à les voir, je les manque. À trop rester empêtrée dans mes pensées, je ne suis pas attentive, et j’arrive comme un boulet en faisant fuir l’animal. Il faut pouvoir être attentif, mais sans attendre. Maintenir la petite tension de la réceptivité, en ayant totalement relâché l’attente, comme on sait maintenir la tension qui permet à notre colonne vertébrale de tenir, tout en relâchant toutes les tensions inutiles. Être en espérance, parce qu’on a enfin relâché l’espoir. L’espoir est une tension. L’espérance est un espoir qui s’est enfin relâché.
En forêt ou à la terrasse d’un café, quand je suis présent.e à ce que je fais, je connais le poids de mon pied, le volume de ma voix, le ton sur lequel je prononce ces mots, le regard que j’impose ou que je refuse à l’autre. Dans ma communication, je sais peser le poids de mon silence comme celui de mon bavardage. Alors je peux m’abandonner à tout ce qui peut advenir. Je sais accueillir une cette rencontre imprévue, ce détour du chemin, cet horaire bousculé, cette nouvelle manière de voir les choses que m’offre quelqu’un qui ne pense pas comme moi…
Disponible et attentif
Un cerf en fuite vient de m’apprendre à marcher dans la vie. Attentif et disponible, en tension et en relâchement. Me laisser porter, mais ne jamais démissionner. Marcher sur mon chemin de vie sans brandir les pancartes de mes désirs, de mes aspirations, de mes peurs ou de mes croyances. Mais bien y marcher avec mon pas, mon déhanché, ma vitesse. En pleine conscience et en pleine vérité de ce que je suis. Ne pas m’absenter, jamais. Pour ne pas faire fuir les chances qui s’offrent. Ne plus espérer que ça arrive, mais me contenter d’être une partie du vent qui forme une grande vague, vers un autre monde possible.
Ce jour-là, j’ai marché avec des œillères. J’ai marché pour fuir un monde qui me ferme toujours ses portes. Si j’avais été attentive au monde que je pénétrais, mon pas aurait été plus léger, et j’aurais repéré le cerf, assez tôt pour m’arrêter avant de l’effrayer. Sa présence aurait été un cadeau. À moins… qu’elle le soit quand même. Et que je n’ai plus qu’à le remercier d’avoir fui ce jour-là.



 English
English Español
Español